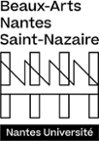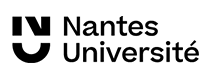Collection de podcasts
La collection de podcasts initiée par la Chaire Sous Le Paysage et menée par DUUU Radio propose d'explorer des enjeux du contemporain, à la croisée des domaines de la création, du vivant, de la philosophie, de l'histoire de l'art non occidentale, de la géologie ou des sciences de la terre.
Les invité·viennent de disciplines, points de vue, expériences ou expertises différentes afin de cultiver l'horizontalité des approches, la transversalité, et une diversité des tonalités et des territoires. Cette collection propose une série d'émissions audio, rassemblées par cycles, comme une reformulation de problématiques ou de mises en lumière, où s'articulent le poétique et le théorique, l'intellectuel et le sensitif, les polyphonies et les savoirs dits « situés ».Cette collection de podcasts a vocation à devenir une base de donnée, une nomenclature dans la recherche engagée par la chaire. Entre archivages de captations audios, studio itinérant de voix et de récits, ces podcasts sont une ressource de diffusion et de recherche, conçu notamment à l'adresse des étudiant.e.s, des Beaux-arts et de l'université.
Cycle 1 : La Vallée
5 épisodes. Enregistrement à La Serrie, dans la bergerie de la Vallée de Fabrice Hyber, Vendée, juillet 2024.Philosophe invité dans le cadre de la chaire Sous le paysage pour l'année 2024, Maxime Rovere s'est intéressé d'abord au cœur du sujet de la chaire : la notion de « paysage ». Il a donc convié l'écrivain et critique d'art Jean-Christophe Bailly, l'artiste Fabrice Hyber, l'activiste Maxime Ollivier, la chercheuse et normalienne Anne Simon et la metteuse en scène Gilberte Tsaï. *(cf. notices bio) pour des échanges enregistrés autour d'une table ronde dans la Vallée de Fabrice Hyber.
Par le biais de cinq émissions radiophoniques, les podcasts de ce Cycle 1 abordent la figure du « paysage » à partir de quatre axes, définis par le philosophe :
- Les contours du paysage
- Les sens dans le paysage
- Les pratiques du paysage
- Les désirs de paysage
- Les sujets du paysage

- Maxime Ollivier : Diplômé de Sciences Po Toulouse, il a participé à la création de La Bascule, mouvement citoyen qui œuvre à la diffusion de nouveaux récits afin de faire émerger un modèle de société basé sur le respect du vivant et de l'humain. Co-fondateur en 2022 du Bruit qui court, collectif d'artistes et d'activistes, son engagement pour une justice sociale et climatique, s'est incarné sous différentes formes d'actions. Il suit actuellement une formation de danse contemporaine au RIDC et dans le Master en Arts Politiques fondé par Bruno Latour à Sciences Po Paris.
- Parmi ses dernières publications : Vivre avec l'éco-lucidité, (avec Tanguy Descamps), Actes Sud, 2024 ; Basculons dans un monde vi(v)able, (avec Romane Rostoll), Actes Sud, 2022.
- Anne Simon : Normalienne, agrégée et docteure en lettres modernes, Anne Simon, est directrice de recherches au CNRS depuis 2001 et responsable du pôle Proust, au centre de recherches République des Savoirs, à l'École normale supérieure depuis 2021. Son travail et de ses écrits portent notamment sur Marcel Proust, les études de genre et les études animales littéraires. En explorant les relations entre le vivant et ses représentations en littérature, ses recherches ont participé à la vitalité des humanités environnementales, de l'écocritique à l'écopoétique, en initiant, en Europe, la zoopoétique tout en contribuant à son développement en Amérique du Nord.
- Parmi ses dernières publications : Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, Tête nue, 2021 ; La rumeur des distances traversées. Proust, une esthétique de la surimpression, Paris, Classique Garnier, Bibliothèque proustienne, 2018.
- Gilberte Tsai : Auteure et metteuse en scène, Gilberte Tsaï fonde la Compagnie Tsaï en 1974 et a développé une approche qui vise la transformation et le métissage de matériaux concrets en forme théâtrale et poétique. Ses projets l'ont amené à travailler avec des écrivains, des peintres ou des jardiniers paysagistes. Pièces, récits, spectacles musicaux ou de marionnettes, elle a adapté des textes d'Honoré de Balzac, d'Italo Calvino et de Robert Walser, et ses productions ont notamment été présentées dans de nombreux pays. Elle a dirigé le Centre dramatique nationale de Montreuil de 2000 à 2011 et crée une nouvelle compagnie L'équipée en 2011, elle est aussi directrice de collection aux éditions Bayard.
- Fabrice Hyber : Fabrice Hyber, formé à l'École des Beaux-arts de Nantes, est un artiste qui intervient dans des domaines et sur des supports très variés et opère de constants glissements entre les domaines du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'installation, et de la vidéo, comme également ceux des sciences et du vivant. Depuis 1986, présente dans de nombreuses collections publiques et privées, son œuvre a fait l'objet de multiples expositions en France et à l'étranger. Il est élu à l'Académie des Beaux-arts en 2018, et devient ambassadeur du fonds « ONF - Agir pour la forêt » en 2021.
- Maxime Rovere : Maxime Rovere est un écrivain, philosophe et traducteur, il a consacré plusieurs livres à la philosophie de Spinoza et publié plusieurs ouvrages sur ses proches recherches en éthique, qu'il réunit sous le terme de philosophie interactionnelle. Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Ecole du Louvre, il a enseigné la philosophie à l'Ecole normale supérieure de Lyon de 2002 à 2007, puis à l'université pontificale catholique de Rio de 2015 à 2019. Il est aujourd'hui chercheur associé en philosophie à l'IRHIM à l'ENS Lyon.
- Parmi ses dernières publications : Que faire des cons ? (Flammarion, 2019) et L'école de la vie (Flammarion, 2020). Le livre de l'amour infini. Vie d'Apollonios, homme et dieu (Flammarion, 2024).
- Jean-Christophe Bailly : Il est écrivain, poète et dramaturge. Docteur en philosophie, il a enseigné à l'Ecole Nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, dirigé la collection Détroits chez Christian Bourgois et la collection d'histoire de l'art 35-37 chez Hazan, les revues Fin de siècle et Aléa. Outre ses pièces de théâtre, il a publié une cinquantaine d'ouvrages, entre essais, fictions, journal de voyage, poèmes et de nombreux articles parus dans différentes publications. Auteur de monographies sur des artistes contemporains, la peinture, l'architecture ou la photographie, les questions du paysage, du vivant et de la cause animale traversent ses réflexions et ses écrits.
- Parmi ses nombreux et différents ouvrages : Temps réel, Paris, Seuil, 2024 ; Le parti pris des animaux, Paris, Seuil, 2013 ; Le dépaysement. Voyages en France, Paris, Seuil, 2011 ; Le versant animal, Paris, Bayard, 2007 ; Le Pays des animots, Paris, Bayard, 2004.

Qu'est-ce qui délimite un espace ou une expérience comme paysage ? Quelles sont les coupures, cadrages, distinctions, séparations, différenciations, qui permettent à la fois d'isoler un paysage et d'en distinguer le plus ou moins grand détail ? Entre l'infini et l'idée de rencontres…
#2 Sens, langage, animalité
Que veut dire « sentir le paysage ? » À quoi correspondrait un apprentissage du paysage ? Quel serait le lien entre des savoirs de la campagne et l'idée de savoir regarder, écouter ? Y aurait-il une perte du paysage qui pourrait en découler ?
#3 Les pratiques politiques et représentations
Quels sont les actes par lesquels on peut jouir d'un paysage, l'explorer ou le faire apparaître, le constituer ou le représenter, y prendre sa place ou s'en distancier ?
#4 Désirs dans le paysage
Qu'est-ce qui motive l'intérêt pour un paysage, voire pour la question même du paysage ? Qu'est-ce que fonde l'émotion esthétique ou la possibilité de la surprise, de la présence, de la rencontre ?
#5 Les sujets du paysage
Quels sont les agents qui instaurent un paysage ? Faut-il toujours le réduire à un ou des subjectivités, ou y a-t-il une objectivité du paysage ? Peut-il avoir laf orme d'un défi pour tout sujet qui s'y trouve impliqué ?

Le fleuve Sépik, et l'art du Sépik, figures, récits et animisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le delta du Niger et les Igbos, masques, animaux, mondes et esprits de l'eau.
#2 Les forêts
Les paysages du Sénégal à la Côte d'Ivoire, les bois, les symboliques et les masques zoomorphes. Les forêts de la côte Nord-ouest de l'Amérique du Nord, les peuples du Saumon, les Premières Nations, le bois de cèdre, chamanisme et animaux. La forêt primaire de Bornéo, chasseurs-cueilleurs, végétaux et animaux mythologiques, les rêves et les motifs textiles.
#3 Les déserts
Le Pérou Ancien, le sud de Lima, le désert d'Atacama, éléments, géoglyphes et instruments de musique de la culture Nazca. Les sociétés des vallées de la côte nord
du Pérou, contextes et rituels funéraires, vases céramiques de la culture Mochica. La culture et le pays Dogon, Afrique de l'ouest, sud-est du Mali, falaises de Bandiagara, objets de culte et d'inhumation, sculptures et paysage chromatique. L'Arctique, les masques et les objets de l'Alaska et du Groenland, objets de la culture Inuit.
Cycle 2 : Les fleuves, les forêts, les déserts
3 épisodes. Enregistrement dans les collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris, 23 septembre 2024.Le Cycle 2 de cette collection de podcast prend comme toile de fond les collections et les vitrines du musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, pour un voyage à travers différents lieux du monde, des peuples et leurs pratiques, des arts et des époques.
À travers des cartographies, des mythes, des objets culturels ou des rites, des savoirs-faire techniques, se lisent les relations de l'humain avec le vivant. Ces récits et descriptions s'animent par les voix des conservateur.rice.s responsables des collections Amériques, Afrique, Insulinde et Océanie du musée du quai Branly Jacques Chirac : Steve Bourget, Aurélien Gaborit, Constance de Monbrison et Magali Mélandri.
Ces trois émissions radiophoniques mènent un tracé entre quatre continents, et donnent à voir et à entendre des organisations et des circulations entre trois types de paysage et d'espaces ou d'entité naturelles :
- Les fleuves
- Les forêts
- Les déserts.

- Aurélien Gaborit : Historien de l’art, diplômé en muséologie à l’École du Louvre et titulaire d’un DEA en histoire des arts de l’Afrique, il a travaillé au Conseil international des Musées puis au musée du quai Branly-Jacques Chirac où il est actuellement Responsable de collections Afrique. Il est également Responsable scientifique du Pavillon des Sessions au Musée du Louvre. Il a enseigné les arts d’Afrique à l’École du Louvre et à la Faculté des arts d'Amiens et l’histoire des collections à l’Institut national du Patrimoine.
- Il a participé à la conception de plusieurs expositions comme commissaire associé pour l’exposition « Les Territoires de l’eau » (2019), commissaire des expositions « Bois sacré » (2014) et « Madagascar. Arts de la Grande Île » (2018)
- Il est l’auteur de plusieurs articles et publications dont le livre « En pays dogon »paru en 2010.
- Constance de Montbrison : Responsable des collections Insulinde au musée du quai Branly- Jacques Chirac, historienne de l’art, elle a collaboré à l’élaboration et à l’installation du parcours permanent des collections océaniennes.
- Elle a été commissaire des expositions « Au nord de Sumatra, les Batak » (2008), « Philippines, archipel des échanges » (2013), « Art of the Great
Ocean » au Musée national de Shanghai sur les arts de l’Océanie (2019) ; co-commissaire des expositions « Les Territoires de l’eau » à la fondation François Schneider à Wattwiller et au Museum of Ar Pudong à Shanghai, « Oceania, culturas de Mar et Islas » au Museo Nacional
de las Culturas del Mondo à Mexico(2023), « Wayang Kulit. Théâtre d’ombres de Java et Bali » au musée du quai Branly-Jacques Chirac (2024).
- Elle a été commissaire des expositions « Au nord de Sumatra, les Batak » (2008), « Philippines, archipel des échanges » (2013), « Art of the Great
- Steve Bourget : Responsable de collections Amériques au musée du quai Branly – Jacques Chirac, il a été conservateur du département Amériques et le directeur de recherche au Musée d'Ethnographie de Genève. Il a également été professeur associé au département d’Art et d’Histoire de l’Art à l’université du Texas,Austin. Il a obtenu son doctorat en anthropologie à l’université de Montréal. Archéologue de formation, il a dirigé des fouilles, pendant plus de 25 ans, sur de nombreux sites précolombiens de la côte nord du Pérou.
- Ses publications les plus récentes : Sacrifice, Violence and Ideology Among the Moche: The Rise of Social Complexity in Ancient Peru (University of Texas Press, 2016), Les rois mochica: Divinité et pouvoir dans le Pérou ancien (Somogy, 2014) et Sex, Death and Sacrifice in Moche Religion and Visual Culture (University of Texas Press, 2006).
- Il a produit plusieurs expositions pour le musée du quai Branly – Jacques Chirac incluant : « Sexe, Mort et Sacrifice » (2008), « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » (2021), « Black Indians de la Nouvelle-Orléans » (2022) et « Mexica – des dons et des dieux au Templo Mayor » (2024).
- Magali Mélandri : Conservatrice en chef du patrimoine, elle est responsable de l’Unité patrimoniale Océanie-Insulinde au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, après avoir accompagné la réouverture du musée départemental Albert-Kahn de 2018 à 2023 en tant que directrice déléguée à la conservation. Elle enseigne l’histoire et l’anthropologie des arts d’Océanie à l’École du Louvre. Ses projets de recherche 2024-2027 mènent sur les peintures sur écorce d’eucalyptus de Terre d’Arnhem (Australie, Premières Nations) et les enjeux de gouvernance des données autochtones dans la documentation de ces collections, ainsi que sur la revitalisation des techniques de tressage en Polynésie française.
- Elle a été commissaire de plusieurs expositions : Rouge Kwoma (2008), L’éclat des Ombres (2015), Autour du monde (2022).